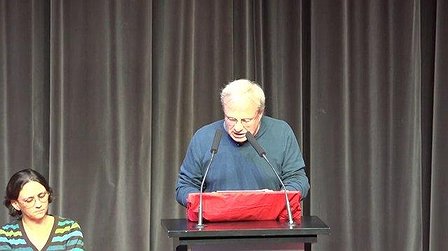La Chine depuis Mao : face aux pressions impérialistes et aux menaces de guerre
Au sommaire de cet exposé
La tension entre les États-Unis et la Chine est réelle. Elle monte, en mer de Chine, autour de Taïwan. Elle se manifeste par une course à l’armement, du côté de la Chine comme du côté des États-Unis, par de nouvelles alliances qui s’organisent comme si les acteurs principaux installaient le décor de la future tragédie, par des manœuvres militaires et des déclarations qui entretiennent de part et d’autre le climat guerrier, alimentent la surenchère.
C’est que la Chine n’est plus ce qu’elle était il y a 40 ans. En en faisant l’atelier du monde et en cherchant à exploiter un marché intérieur de plus en plus vaste, les puissances impérialistes, États-Unis en tête, lui ont permis de devenir une puissance régionale incontournable dont le développement heurte aujourd’hui, et de façon inexorable, les intérêts de ces mêmes puissances, en particulier l’impérialisme américain qui domine la planète depuis la Seconde Guerre mondiale.
Sommes-nous à la veille d’un conflit d’ampleur impliquant la Chine et les États-Unis ? Nous ne sommes pas devins mais la dynamique, sur laquelle nous allons revenir ce soir et qui est à la source des tensions croissantes entre la Chine et les États-Unis, est toujours à l’œuvre, tel un engrenage inexorable.
La responsabilité des États-Unis est écrasante. Ils sont à la manœuvre depuis 70 ans. Embargo puis ouverture, endiguement aujourd’hui : depuis que le Parti communiste chinois a pris le pouvoir en 1949, les États-Unis ne sont pas parvenus à soumettre ce régime nationaliste. Alors que le capitalisme s’enfonce dans une crise sans fin, ils ne peuvent pas tolérer l’émergence d’une puissance qu’ils ne contrôlent pas et qui dans certains secteurs et dans certaines zones les concurrence. La guerre qu’ils mènent pour l’instant sur les seuls terrains commercial et économique prépare les conflits militaires de demain.
Mais l’impasse dans laquelle se trouvent aujourd’hui les peuples est aussi celle du nationalisme. Le parti dirigé par Xi Jinping qui est au pouvoir en Chine se dit communiste, il prétend même construire un « socialisme aux caractéristiques chinoises ». Son nom lui vient de son histoire, qui commença quatre ans après la révolution ouvrière russe de 1917, qui inspirait ses fondateurs. Mais le cours de son histoire fut détourné sur la voie nationaliste bourgeoise, par la bureaucratie stalinienne. Il finit par renoncer à la révolution socialiste pour chercher à construire une économie capitaliste nationale dans un monde dominé par l’impérialisme. La Chine construite par Mao et ses successeurs est un État bourgeois, basé sur l’exploitation de la classe ouvrière et de la paysannerie chinoises. S’il s’est construit de façon indépendante de l’impérialisme, voire à certaines périodes contre lui, il se heurte aujourd’hui aux limites que l’impérialisme a fixées. Il s’y heurte de puissance à puissance sans d’autres perspectives pour sa survie qu’une nouvelle ère de barbarie.
1949 – 1971, la Chine sous embargo
Un siècle d’humiliation
Pour justifier sa politique nationaliste et autoritaire, Xi Jinping n’hésite pas à ramener au souvenir des Chinois l’humiliation que les puissances impérialistes ont fait subir à la Chine pendant plus d’un siècle, des années 1840 à la révolution chinoise de 1949. L’Empire chinois, alors dominé par la dynastie Qing était un vaste État, le plus peuplé du monde. La bureaucratie et les seigneurs féodaux y exploitaient des centaines de millions de paysans sans terre. Le siècle d’humiliation commença en 1840, quand les soudards de l’impérialisme anglais puis français ont ouvert à coups de canon l’Empire chinois au commerce de l’opium. Dans cette guerre de l’opium, l’Empire chinois fut vaincu et les diplomates occidentaux, s’appuyant sur leurs détachements militaires, purent régenter la Chine afin que leurs usuriers puissent la dépecer et l’affamer.
Après avoir mis sous tutelle la dynastie régnante, les forces armées de cette coalition impérialiste la protégèrent, jusqu’en 1911, contre les révoltes populaires qui pendant 70 ans secouèrent constamment le pays. Ce fut le temps des canonnières occidentales qui remontaient les fleuves pour massacrer les populations qui se soulevaient. La dynastie finit par chuter et la république fut proclamée en 1911 à Nankin par un nationaliste, Sun Yat Sen. Mais ni lui, ni son parti, le Kuomintang, n’héritèrent du pouvoir dans la nouvelle république.
En fait, l’effondrement de la dynastie laissa la place à une série de cliques militaires qui se succédèrent à Pékin. Quant à « l’unité de la Chine », c’était plus que jamais une fiction. De 1917 à 1927, plus de 1 500 chefs militaires, petits et grands seigneurs de guerre, dévastèrent le pays. Les Occidentaux s’adaptèrent à la situation. À chaque nouvelle menace révolutionnaire, à chaque ébranlement du pouvoir en place, les canonnières occidentales bloquaient les ports et débarquaient leurs troupes, laissaient fusiller les étudiants contestataires ou les grévistes quand ils ne participaient pas directement aux fusillades, en attendant de contracter des arrangements crapuleux avec la clique qui s’apprêtait à remplacer la précédente au pouvoir.
Mais à partir de 1923, en grande partie sous l’effet des succès de la Révolution russe, le mouvement nationaliste bourgeois et le mouvement ouvrier grandirent conjointement à une vitesse extraordinaire. À n’en pas douter, une révolution semblable à celle qu’avait connue la Russie en 1917 était en train de mûrir. Pendant deux ans, de 1925 à 1927, des dizaines puis des centaines de milliers d’ouvriers s’insurgèrent. Répondant aux fusillades des Occidentaux, ils manifestèrent et firent grève, paralysant pendant des mois les grandes villes comme Canton et Hong-Kong. Les ouvriers et les paysans qui se révoltaient eux aussi à leur suite, mettaient de plus en plus leurs espoirs dans une révolution sociale qui, balayant les classes possédantes, chinoises et étrangères, aurait mis fin à leur oppression séculaire. Le Parti communiste chinois, fondé en 1921 par une poignée d’intellectuels, organisa en peu de temps des milliers d’ouvriers, à Canton, à Shanghai qui marchaient dans les pas de la révolution ouvrière russe. Mais la dégénérescence de l’État ouvrier soviétique, fruit de son isolement dans un pays arriéré, gagna la Troisième internationale, cette internationale qui organisait les partis communistes du monde entier. À partir du moment où Staline en prit la tête, ces partis communistes commencèrent à trahir les idées sur lesquelles ils s’étaient fondés. En Chine, au prétexte que la révolution devait, selon Staline, d’abord être bourgeoise, le jeune parti communiste dut se fondre dans le Kuomintang, le parti nationaliste bourgeois. L’Internationale fournit des conseillers au Kuomintang, l’aida à former une armée, qui entreprit en 1926, en partant de Canton sous la direction de Tchang Kaï-Chek, sa marche vers le Nord et le pouvoir.
À Shanghai, à Pékin, la bourgeoisie chinoise était des plus inquiètes des soulèvements populaires qui accompagnaient la marche de l’armée du Kuomintang. Elle avait vu se transformer les grèves en grève générale et à Shanghai, c’était maintenant l’insurrection ouvrière. Ses intérêts étaient tout autant en jeu que ceux des capitalistes étrangers qui s’étaient barricadés dans leurs concessions. Mais tous furent vite rassurés. En 1927, en arrivant sur Shanghai où les travailleurs et les communistes avaient pris le pouvoir pour le lui remettre, Tchang Kaï-Chek conclut un accord avec les banquiers et les hommes d’affaires anglais, américains et français. Il fit fusiller des milliers d’ouvriers et de militants. Le massacre de Shanghai ouvrit une longue période de terreur blanche, pendant laquelle les progrès de l’armée nationaliste se conjuguaient dorénavant avec les massacres des paysans et des ouvriers rouges. Les puissances étrangères avaient enfin leur nouvel homme fort en Chine, Tchang Kaï-Chek, et le danger communiste était écarté. Il ne restait, disaient bourgeois chinois et diplomates, que quelques bandits isolés dans les campagnes. Le mouvement communiste prolétarien qui avait tant effrayé la bourgeoisie chinoise, était en effet réduit à quelques petites troupes d’hommes en débandade dirigées par un certain Mao Zedong.
Pour reprendre les termes de Harold Isaacs qui décrivit cette révolution, la défaite des ouvriers en 1927 était une tragédie, à plusieurs niveaux. Sous prétexte de vaincre les seigneurs féodaux et l’impérialisme, Staline avait contraint les ouvriers et les paysans chinois à se ranger derrière la bourgeoisie et son parti nationaliste. Pourtant, la révolution russe avait démontré qu’une telle politique était une impasse. En Russie en 1917, les ouvriers, alors qu’ils étaient comme en Chine minoritaires, avaient démontré qu’ils étaient la seule force sociale capable de sortir la société du féodalisme et de s’opposer à l’impérialisme. Ils avaient dû pour cela renverser la bourgeoisie en prenant le pouvoir en s’appuyant sur les paysans. La victoire des soviets russes pouvait être le début d’une révolution qui, si elle avait entraîné la classe ouvrière des pays occidentaux, aurait conduit au renversement du capitalisme à l’échelle mondiale. Après les échecs révolutionnaires de 1919 à 1923 en Allemagne et de 1919 en Hongrie, la révolution prolétarienne chinoise aurait pu être pour les travailleurs du monde entier un encouragement à repartir à l’assaut. Elle aurait pu aussi remobiliser la classe ouvrière russe contre la bureaucratie stalinienne. La défaite renforça au contraire sa dictature.
L’autre conséquence de la défaite des ouvriers en 1927 fut que le parti communiste changea de nature. La répression, son isolement de la classe ouvrière le transformèrent en un parti nationaliste radical. Dès cette époque, il n’avait plus de communiste que son nom. Mao, qui avait pris sa tête, l’orienta vers la constitution de bases militaires à la campagne. En 1932, Trotsky écrivait que « la plus grande partie des communistes du rang dans les corps de partisans rouges se compose de toute évidence de paysans qui, très honnêtement et sincèrement, se prennent pour des communistes, mais qui sont des révolutionnaires « paupérisés » ou des petits propriétaires révolutionnaires. […] Parmi les dirigeants, il y a, sans aucun doute, pas mal d’intellectuels ou de semi-intellectuels déclassés qui ne sont pas passés par la sérieuse école de la lutte prolétarienne. Durant deux ou trois ans, ils vivent la vie des commandants et des commissaires de partisans. Ils commandent, ils conquièrent des territoires…»[1] Les armées rouges qui se constituèrent dans ces années-là ne se distinguèrent de celles des seigneurs de guerre qu’en étant plus respectueuses des paysans sur lesquels elles vivaient, une façon d’être tolérées plus longtemps. Pourchassées, elles avaient fini par trouver refuge dans une province reculée du Nord, quand l’impérialisme japonais envahit la Chine en 1937. Face au Japon, Mao et Tchang trouvèrent un accord. Le Parti communiste chinois renonçait officiellement à renverser le Kuomintang par la force. L’armée rouge était réorganisée et placée sous le contrôle direct du commandement régional du Kuomintang sous le nom de Huitième Armée de route. La guerre contre l’impérialisme japonais allait être le tremplin du Parti communiste chinois vers le pouvoir.
La guerre fait changer les maîtres
C’est à cette époque que le rôle de l’impérialisme américain devint central en Chine. Avant la Seconde Guerre mondiale, les impérialismes français, allemand, anglais y étaient très présents. À partir de 1940, la France et l’Angleterre étaient hors course. Les deux seuls qui restèrent en présence étaient le Japon, allié de l’Allemagne, et les États-Unis, face à face, en lutte pour la domination mondiale.
De fait, les États-Unis ne lésinèrent pas sur l’aide militaire au Kuomintang, seul gouvernement que reconnaissait également l’URSS tandis que les troupes communistes ne bénéficiaient d’aucune aide, ni américaine, ni même soviétique. Elles devaient se contenter des armes prises à l’ennemi. Malgré cela, jusqu’à la capitulation du Japon devant les États-Unis en 1945, les territoires contrôlés par les nationalistes ne cessaient de rétrécir, alors que les régions libérées tenues par les troupes de Mao s’étaient peu à peu étendues. Ces troupes communistes regroupaient en 1945 près d’un million de soldats et deux fois plus de miliciens. Elles faisaient corps avec la population. Non seulement, elles avaient allégé la fiscalité, diminué les taux de fermages, mais c’était bien la première fois que le paysan chinois voyait une armée qui ne vivait pas de rapines et de pillages, mais qui au contraire, entre deux combats, se livrait aux travaux des champs et subvenait ainsi en grande partie à ses propres besoins.
Dans la zone nationaliste le régime était non seulement détesté par la paysannerie, qui y était écrasée sous les impôts et les réquisitions, mais aussi même par de larges couches de la bourgeoisie, qui trouvaient que la dictature de Tchang Kaï-check était devenue trop étouffante, synonyme de corruption, de pots-de-vin et d’influence. Ce parasitisme se doublait d’une inefficacité militaire patente – la bureaucratie Kuomintang revendait sur le marché noir jusqu’aux armes qu’elle avait reçues des États-Unis –, une armée où selon le témoignage de Jack Belden dans La Chine ébranle le monde, « les officiers considéraient que battre les soldats, des paysans pauvres, étaient leur privilège », une armée qui « n’avait pas d’âme ».
La révolution de 1949
La fin de l’occupation japonaise déclencha une véritable révolution paysanne. Le PC de Mao, après bien des hésitations en prit la tête. Alors que Mao, pour ne pas s’aliéner les seigneurs dits patriotes, n’avait pour programme agraire que quelques mesures modérées, de réduction des loyers, les paysans faisaient de plus en plus confiance aux partisans rouges qui les respectaient et leur apprenaient l’autodéfense contre l’occupant japonais. Cette occupation avait été atroce en Chine du Nord. Les seigneurs féodaux s’étaient fait les exécutants intéressés des exactions japonaises. Les paysans, qui avaient courbé le dos pendant des mois se révoltaient maintenant y compris contre les seigneurs. Mais comme le rapporte Jack Belden : « Le Parti Communiste lanterna […] Les demandes des paysans augmentèrent d’intensité. L’hiver de 1946 vint et passa. Toujours pas de décision. Le printemps vint. Les communistes hésitaient encore […] Un pas en arrière, paix avec les seigneurs ; un pas en avant, guerre contre le régime féodal. »
En fait, le PCC était toujours disposé à traiter avec Tchang Kaï-Chek ; sa seule revendication véritable était un gouvernement de coalition, une position longtemps soutenue par l’impérialisme américain. C’est Tchang Kaï-Chek qui rompit. Il s’inquiétait de voir le PCC grandir en force et en influence. La bourgeoisie, elle, n’en pouvait plus. Jack Belden rapporte les propos d’un patron de 3 000 ouvriers fuyant la zone nationaliste, « approuvant la révolution agraire parce que l’industrie ne peut se développer sans elle » et qui ne comprenait pas « pourquoi l’Amérique entretenait délibérément la guerre en aidant Tchang Kaï-Chek ». Sur le plan international, les États-Unis s’orientaient vers la rupture de leur coopération avec l’URSS. C’était les prémisses de la guerre froide. Tout cela décida Mao. « Au cours de l’été de 1946, des courriers apportèrent aux commissaires l’ordre suivant : partagez la terre. Le sort en était jeté. Le Parti Communiste avait choisi. ». Très vite, les armées du Kuomintang, vomies par la population, furent battues et rejetées à la mer. Tchang Kaï-Chek, accompagné de plusieurs dizaines de milliers d’hommes, se réfugia à Taïwan.
Ainsi, après la victoire de Mao, les puissances impérialistes avaient disparu de la Chine continentale. Ce résultat n’était pas seulement la conséquence de la lutte du peuple chinois, c’était aussi un contrecoup de la Seconde Guerre mondiale. En se dévorant entre elles, les puissances impérialistes avaient fini par s’éliminer mutuellement de Chine.
La vieille Chine était morte, et bien morte. Mais le Parti communiste chinois n’était pas un parti révolutionnaire prolétarien. Il se méfiait des ouvriers qu’il maintint soigneusement à l’écart de la révolution paysanne. Comme l’avait pressenti Trotsky dès 1932, en entrant dans les villes, les commandants communistes furent « avant tout enclins à regarder les ouvriers de haut en bas », considérant leurs « revendications comme inopportunes et mal venues »[2]. L’extension de la révolution, la révolution mondiale n’étaient pas le problème du Parti communiste arrivé au pouvoir sur les épaules des paysans révoltés. Son problème était de construire une économie nationale, résistant à la tutelle de l’impérialisme, et permettant à la bourgeoisie chinoise de survivre. C’était en fait la continuation du rêve du nationaliste Sun Yat Sen, une révolution nationale bourgeoise, qui allait vite se heurter à la bourgeoisie elle-même et à l’impérialisme.
Taïwan, une créature de l’impérialisme
Si les États-Unis avaient été chassés du continent chinois avec les nationalistes, il leur restait cependant une carte, Taïwan qui devint leur pied-à-terre régional, leur base avancée.
Taïwan est une petite île de 30 000 km² située à moins de 200 km de la côte sud-est de la Chine, habitée aujourd’hui par un peu plus de 23 millions d’habitants. L’île a été longuement gouvernée par la Chine impériale avant de devenir en 1895, après sa défaite face à l’impérialisme japonais naissant, une colonie du Japon.
Dès 1945, l’état-major américain fit de Taïwan une base militaire, équipant et entraînant les divisions du Kuomintang envoyées sur le continent pour tenter d’endiguer l’avancée des troupes de Mao. Dans un premier temps, la population de l’île accueillit avec soulagement le départ des colonisateurs japonais. Mais l’appareil du Kuomintang se comporta comme en Chine continentale, animé par le seul souci de se remplir les poches en se payant sur l’habitant.
La révolte qui démarra le 27 février 1947 contre le Kuomintang dura deux semaines et fut écrasée. Pendant une semaine, nuit et jour, les troupes du Kuomintang se livrèrent à des exécutions à la chaîne, passant par les armes tous ceux qui se trouvaient sur leur chemin, faisant entre 10 000 et 30 000 morts. C’est ainsi que l’île put devenir en 1949, sous la protection des troupes américaines, le dernier refuge des troupes nationalistes.
Dans les années 1950 et 1960, il y eut plusieurs incidents avec la Chine sur des îlots autour de Taïwan. Mais les États-Unis avaient choisi le statu quo. Ils ne tenaient pas à se laisser entraîner dans une aventure militaire pour quelques cailloux. Ils avaient imposé à Taïwan de s’interdire toute opération militaire en cas d’attaque chinoise sur les îlots sans l’accord préalable des États-Unis.
Sur l’île, ce fut quarante années de terreur blanche, 140 000 personnes furent emprisonnées en raison de leurs sympathies pour le Parti communiste chinois ou de leur opposition au gouvernement nationaliste. Entre 3 000 et 4 000 d’entre elles furent exécutées. Et l’île devint un bagne pour la classe ouvrière. La loi martiale n’y fut levée qu’en 1987 ce qui permit au régime de se donner une façade démocratique à partir des années 1990.
Les États-Unis financèrent en grande partie le développement de la bourgeoisie locale et de son industrie. Des milliards de subventions directes venaient s’ajouter à l’aide militaire et aux retombées sonnantes et trébuchantes de la guerre du Vietnam pendant laquelle Taïwan servit de base arrière pour les troupes américaines. C’est comme cela que l’impérialisme américain fit de cette île gouvernée par les gangsters nationalistes le flambeau de la lutte des « démocraties » contre le « communisme totalitaire ».
L’impérialisme met la Chine sous embargo
Dans la Chine continentale, Mao Zedong se donnait comme objectif de moderniser le pays et de développer l’économie chinoise selon les voies bourgeoises. Il ne s’en cachait pas. En 1945, par exemple, il s’expliquait : « Étant donné que la révolution ne vise pas la bourgeoisie en général mais l’oppression impérialiste et féodale, le programme de la révolution n’est pas d’abolir la propriété privée mais de protéger la propriété privée en général ; cette révolution ouvrira la voie au développement du capitalisme. »
Si le régime chinois fut contraint de nationaliser des entreprises, ce n’était donc pas parce qu’il était prolétarien, mais parce qu’il n’avait pas d’autres choix. En 1949, la Chine était toujours un pays agricole arriéré. La bourgeoisie chinoise était essentiellement compradore, simple intermédiaire dans le commerce avec l’impérialisme. La maigre industrie nationale était élémentaire, techniquement arriérée, ou avait été importée des pays étrangers. Et après près de 20 années de guerre et de révolution, une partie en avait été détruite. La bourgeoisie était donc des plus faibles, l’économie passablement ruinée. L’impérialisme américain allait aggraver encore les choses. Sa politique, depuis 1947 et le début de la guerre froide, était celle du « containment ». Il s’agissait d’empêcher toute extension de la sphère d’influence de l’URSS. L’éclatement de la guerre de Corée, en juin 1950, et la participation chinoise du côté de la Corée du Nord, lui donnèrent un prétexte pour imposer à la Chine un blocus économique et politique qui devait durer plus de vingt ans.
La Chine sous embargo devait trouver l’essentiel de ses ressources et de ses moyens de production dans ses limites nationales. Elle fut privée sur la scène internationale de tout droit d’expression et de toute représentation. À l’ONU, son siège fut occupé par Taïwan, qui comptait alors huit millions d’habitants, alors que la République populaire en comptait 500 millions.
Au pouvoir, le PCC valorisa, comme pendant la guerre civile, les capitalistes « nationaux patriotes ». Les actionnaires des entreprises touchaient des dividendes, fixés par règlement. Le problème principal vint des capitalistes eux-mêmes. Ceux qui n’avaient pas fui fraudaient le fisc à grande échelle, sabotaient les commandes d’État tout en versant les pots-de-vin à qui il fallait. Bref, la bourgeoisie se comportait comme elle le fait partout et rendait de toute façon impossible tout développement national digne de ce nom.
C’est ainsi que le régime, qui voulait sortir le pays du sous-développement malgré l’embargo, fut amené en 1955 à nationaliser, à racheter en fait, les entreprises industrielles et commerciales. Il ne rencontra guère de résistance. La conduite des entreprises nationalisées était souvent confiée aux anciens propriétaires, élevés au rang de « capitalistes nationaux patriotes qui empruntent courageusement la voie du socialisme ».
Pendant plus de vingt ans, ce fut donc l’État qui organisa l’essentiel de l’activité économique, permettant des progrès importants, sur le dos de l’immense paysannerie chinoise qui constituait encore les trois quarts de la population à la fin des années 1970. L’agriculture, qui avait été collectivisée dans les années 1950, fut quelque peu modernisée, les rendements augmentés. Dans les campagnes et dans les usines régnait un certain égalitarisme, mais sur un fond de pauvreté générale. Sur ces bases, l’industrie, qui partait de très loin, progressa de 9 % par an en moyenne, en développant les industries de base comme la sidérurgie. La proportion de Chinois sachant lire et écrire passa de 20 % en 1949 à 75 % en 1978, l’espérance de vie passa de 38 à 64 ans sur la même période. Bref, contrairement à ce que répètent les commentateurs occidentaux, l’étatisme n’a pas freiné le développement de la Chine, il l’a au contraire permis, réalisant en quelque sorte une accumulation primitive qui allait se révéler essentielle pour la suite.
Une aide soviétique… limitée
Dans cette accumulation primitive, l’aide soviétique joua un rôle important. Dans la première moitié des années 1950, les relations sino-soviétiques étaient placées sous le signe de la coopération. L’attestent les très nombreux projets de développement économiques et industriels et l’envoi en Chine de milliers de techniciens soviétiques. Mais, contrairement à tant d’autres pays dépendant du « grand frère » soviétique, la Chine avait les moyens de jouer son propre jeu. Elle soutint le Vietminh pendant la guerre d’Indochine contre la France, et elle envoya plus d’un million de « volontaires » mener la guerre de Corée aux côtés de la Corée du Nord entre 1950 et 1953, alors que l’URSS respecta les accords passés avec les États-Unis sur le dos du peuple coréen.
Les relations entre la Chine et l’URSS se tendirent après la mort de Staline en 1953, quand Khrouchtchev, de retour des États-Unis, se mit à faire la promotion de la « coexistence pacifique » entre l’impérialisme américain et l’URSS. Les Chinois craignaient que l’URSS ne les lâche pour pouvoir se rapprocher des États-Unis. En juillet 1960, les conseillers soviétiques furent rappelés en URSS. En 1962, la Chine reprocha à l’URSS de s’être écrasée devant les États-Unis lors de la crise des missiles de Cuba. En 1963, les liens diplomatiques entre Chine et URSS étaient officiellement rompus, et comble du comble, la Chine se permit d’entrer en guerre contre l’URSS à propos de leur frontière en Mandchourie, en 1969.
La rupture entre les deux pays prit l’apparence d’un conflit idéologique entre deux courants du monde dit communiste. En réalité, les causes de la crise résidaient dans la nature des deux pouvoirs. Même si les deux régimes se disaient communistes, ils ne l’étaient ni l’un ni l’autre. Les deux États représentaient les intérêts des classes et des couches privilégiées de leur propre pays. L’URSS était le fruit d’une révolution ouvrière trahie par une vaste bureaucratie, la Chine de Mao était issue d’une révolution nationale bourgeoise, et les intérêts des deux États ne coïncidaient pas. Tant que les États-Unis faisaient la guerre froide à l’URSS et imposaient un embargo à la Chine, les deux régimes pouvaient coopérer. Mais la tentative de rapprochement entre l’URSS et les États-Unis opérée à cette époque ne pouvait se faire qu’au détriment de la Chine.
C’est pour ces raisons que la Chine s’opposa à l’URSS. Et on pouvait gager qu’on la verrait vite changer de ton si les Américains lui faisaient des avances, ce qui n’allait pas tarder, après que la Chine eut fait la guerre à l’URSS en Mandchourie.
1971 – 2011, l’engagement américain
1971, le tournant de la politique américaine
Contrairement à ce qu’on nous dit souvent, la sortie de la Chine de son isolement n’est pas dû à un tournant dans la politique chinoise suite à la mort de Mao Zedong en 1976. Il s’agit en réalité d’un tournant dans la politique des États-Unis qui s’est d’ailleurs effectué du vivant de Mao Zedong dès la fin des années 1960.
La longue guerre que les États-Unis menaient au Vietnam l’avait transformé en un bourbier dont ils n’arrivaient pas à se dégager, et qui leur créait de plus en plus de problèmes intérieurs, économiques et politiques, notamment la révolte de la jeunesse et des Noirs. Le Vietnam était perdu mais une retraite précipitée aurait pu être le signal de la révolte pour d’autres peuples. Pour les maintenir dans leur sphère, les États-Unis ne pouvaient plus compter sur la seule force militaire. La Chine avait le poids pour maintenir les peuples en laisse. Avec son appui, les États-Unis pouvaient espérer sortir du bourbier vietnamien sans que d’autres peuples se sentent autorisés à s’émanciper à leur tour.
Les États-Unis savaient qu’une entente avec Pékin était possible parce que fondamentalement la Chine, comme l’URSS, y ont toujours été prêtes pourvu qu’elle garantisse le statu quo mondial, et donc leur existence. Ce sont les États-Unis qui avaient rompu les fils à partir de 1947, il ne dépendait que d’eux de les renouer. Et la rupture entre la Chine et l’URSS montrait aux États-Unis qu’ils pouvaient s’appuyer sur la Chine en la jouant contre l’URSS. Aussi dès 1969, dans la foulée de la guerre sino-soviétique, les États-Unis décidèrent d’assouplir un peu les relations avec Pékin. Dès 1971, les diplomates de la République Populaire de Chine remplacèrent ceux de Tchang Kaï-Chek aux Nations-Unies. En février 1972, le président américain Richard Nixon se rendit en Chine. Mao ne lui posa pas de condition sur Taïwan. Le régime chinois était en réalité acculé. L’économie était dans une impasse, la « révolution prolétarienne culturelle », lancée quelques années plus tôt pour réaffirmer la mainmise de Mao sur le PCC, était une catastrophe qui laissait la Chine exsangue.
La rencontre de 1972 fut le signal, fort bien entendu par les alliés des États-Unis, que ces derniers ne s’opposaient plus à ce qu’ils aient des relations officielles, y compris sur le plan économique, avec la Chine.
Quant à la Chine, elle démontra vite qu’elle respecterait les termes du nouveau contrat. Elle encouragea l’écrasement d’une révolte qui se réclamait pourtant du maoïsme à Ceylan en 1971, et elle appuya le Pakistan contre la sécession du Bangladesh, prenant dans les deux cas une attitude similaire à celle des États-Unis.
La grande amitié sino-américaine
La crise économique mondiale des années 1970 accéléra le rapprochement entre les deux pays. Ils officialisèrent en 1979 leurs relations diplomatiques. Les États-Unis déplacèrent leur ambassade à Pékin. Deng Xiaoping, qui avait réussi à prendre les rênes du pouvoir après la mort de Mao en 1976, entreprit une tournée aux États-Unis en janvier 1979, pendant laquelle il lança la coopération économique officielle entre les deux pays : des centaines de projets de recherche en commun furent mis sur pied et, dans le courant de l’année 1979, un premier accord commercial bilatéral fut signé. Deng Xiaoping fit la une de Time comme homme de l’année 1978.
La politique des États-Unis consistait à utiliser la Chine au mieux de leurs intérêts. Alors que la crise frappait l’économie mondiale depuis le milieu des années 1970, les puissances capitalistes occidentales étaient décidées à faire remonter le taux de leurs profits en sous-traitant leur production la plus courante dans des pays à bas salaires. En outre, l’ouverture de la Chine promettait aux entreprises occidentales un vaste marché vierge, vu dès 1979 par les banquiers et les industriels américains comme le « marché du siècle ». Chacun rêvait de vendre pour un dollar de marchandises à chaque Chinois. Alors que les exportations des États-Unis vers la Chine se montaient à 172 millions de dollars en 1977, elles atteignaient le milliard en 1978 en électro-ménager, en biens de consommation que la Chine ne savait pas produire. Elle, elle exportait du pétrole et du textile.
Dans les années 1980, la Chine et les États-Unis ont échangé de nombreux secrets, y compris militaires, technologiques, dans une coopération toujours croissante. En 1984, Ronald Reagan, anti-communiste notoire, affirmait à Pékin au Premier ministre chinois : « Nous nous sommes engagés à être amis », et il ajoutait, tant cela pouvait être étonnant : « Cette promesse est solide. » Tous les dirigeants chinois envoyaient leurs enfants faire des études dans les meilleures écoles supérieures américaines et la mode chinoise dans les hautes sphères était de donner à ses enfants un prénom américain.
Les réformes économiques en Chine ont été très progressives. Grâce à la réintroduction du marché à la campagne et la décollectivisation des terres entre 1978 et 1984, une couche de paysans commença à s’enrichir et à concentrer les terres. Certains se lançant dans des activités commerciales et industrielles en créant de petites entreprises dans les campagnes. Ces réformes économiques et le parrainage américain furent le signal pour la bourgeoisie chinoise émigrée, la diaspora, qu’il était possible de revenir au pays et d’y ramasser de faramineux profits. La plupart des Chinois de la diaspora étaient des émigrés de la Chine du Sud, en particulier des villes du delta de la rivière des Perles, autour de Canton, non loin de Hong Kong. Ils avaient émigré au début du 20e siècle ou en 1949. Ils comptaient en 1992 50 millions de personnes, dont 17 à Taïwan, 5 à Hong Kong, 2 aux États-Unis…
Pour attirer la diaspora de Hong Kong, Deng Xiaoping ouvrit deux des quatre premières zones économiques spéciales (les ZES) au Guangdong, juste de l’autre côté de la frontière. Ses membres bénéficiaient d’un traitement privilégié. Les salaires dans les ZES étaient en 1978 dix fois moins élevés qu’à Hong Kong, les terrains trois fois moins chers. Les exonérations de droits de douane, les allègements d’impôts sur les personnes et sur les bénéfices convainquaient les bourgeois émigrés d’y délocaliser leurs industries et d’y localiser leurs nouveaux investissements. Ainsi en 1992, l’industrie hongkongaise employait 800 000 personnes sur Hong Kong même et 2,5 millions dans le Guangdong. Les industriels de Taïwan se déployèrent quant à eux dans la ZES du Fujian, juste de l’autre côté du détroit de Taïwan. Au début des années 1990, la diaspora contrôlait à elle seule les deux tiers des investissements étrangers en Chine, beaucoup dans le textile et la chaussure. Bref, la bourgeoisie retournait au pays.
Ceux des capitalistes qui connaissaient les rouages de l’État chinois, ou qui avaient des relations en son sein, le réseau, guanxi en chinois, étaient particulièrement avantagés. Ils servirent d’intermédiaires à nombre de capitalistes occidentaux. Mais ils servirent aussi de prête-noms pour nombre de membres des couches dirigeantes chinoises qui recyclèrent dans les ZES les sommes qu’ils détournaient en Chine même, l’argent revenant blanchi sous la forme d’un investissement étranger bénéficiant de nombreux avantages. En 1993, un journaliste estima qu’en trois années, de 1990 à 1992, entre 30 et 40 milliards de dollars avaient été recyclés de cette manière. Hong-Kong en particulier fut pour les dirigeants chinois un lieu de trafics et d’apprentissage du capitalisme moderne, en particulier pour les dirigeants des provinces et des municipalités. Ces Chinois des hautes sphères de l’appareil d’État chinois, ou leurs enfants, se sont inscrits dans la vie locale, s’y sont mariés, ont été nommés au sein de branches locales de sociétés chinoises.
Une figure émerge dans ces années-là, c’est celle de Rong Yiren, héritier d’une dynastie de capitalistes shanghaiens. Alors que quatre de ses six frères avaient quitté la Chine lors de la révolution, il resta et continua à diriger les entreprises familiales, même quand le gouvernement en prit le contrôle en 1956. Alors qu’il n’adhérait pas au PCC, il fut nommé adjoint au maire de Shanghai en 1957, vice-ministre de l’Industrie textile en 1959. En 1979, Deng lui demanda de former une société pour attirer les capitaux étrangers. La CITIC, publique sur le papier, fonctionnait en réalité comme une entreprise capitaliste : elle gérait une banque en concurrence avec les banques d’État, arrangeait des prêts, investissait et importait des équipements pour les entreprises chinoises, possédait des entreprises et des succursales à l’étranger. La CITIC devint un repaire de fils de dignitaires qui, nommés à des postes de direction, y réapprirent les lois du marché, de l’accumulation et de la prédation. Après avoir été vice-président de l’Assemblée populaire nationale, Rong fut élu vice-président de la Chine de 1993 à 1998. À la CITIC, c’est son fils, Larry Yung, qui prit sa suite.
Le marché du milliard
Les premiers investissements de la diaspora chinoise de Hong-Kong et de Taïwan ont fait la démonstration que les capitalistes occidentaux et japonais pouvaient dorénavant faire du profit en Chine. L’État chinois leur déroula le tapis rouge. Il se fit en quelque sorte l’agent de l’impérialisme sur le sol chinois, l’introduisant, faisant tout pour lui garantir le marché et les profits.
L’automobile est un cas d’école. Née en 1955, l’industrie automobile ne produisait en 1980 que 5 000 voitures individuelles par an. Fin 2000, elle employait 2 millions de personnes et sa production annuelle dépassait 600 000 voitures individuelles, 100 fois plus que 20 ans auparavant, mais encore bien peu dans ce vaste pays. En 1989, le marché était organisé par l’État chinois, la production répartie entre différents constructeurs. L’un des premiers investisseurs étrangers fut l’allemand Volkswagen qui choisit en 1985 pour partenaire la SAIC, la Shanghai Automobile Industrial Corporation, une entreprise détenue par la ville de Shanghai, qui fabriquait déjà des voitures et disposait d’un réseau de fournisseurs et d’un réseau commercial. Volkswagen obtint de l’État chinois, au travers de cette joint-venture, 60 % du marché. Avec l’aide des autorités chinoises, Volkswagen avait trouvé une solution sans risque.
L’entrée des entreprises multinationales sur le marché chinois leur fut donc d’emblée fort profitable. Les joint-ventures créées avec des partenaires américains, européens et japonais avaient une productivité quatre fois supérieure à la moyenne de celle de l’industrie chinoise et plus de cinq fois supérieure à celle des entreprises d’État.
Mais ce fut pendant les années 1990 et 2000 que les entreprises occidentales, de façon directe ou indirecte, investirent largement sur le territoire chinois. En 2002, ce n’était plus Taïwan et Hong Kong qui étaient les premiers investisseurs étrangers mais le Japon et les États-Unis. La Chine, avec les avantages fiscaux des ZES, des travailleurs qualifiés et maigrement payés, présentait un avantage concurrentiel manifeste. Dans l’automobile par exemple, le nombre de joint-ventures est passé de 20 en 1989 à 600 fin 2000. Bien sûr, les entreprises chinoises en profitèrent pour acquérir des technologies qu’elles ne maîtrisaient pas, et comblèrent ainsi une partie de leur retard au point qu’elles sont aujourd’hui capables de concurrencer les entreprises de l’automobile occidentales. Mais les capitalistes occidentaux y gagnèrent des milliards. Ils n’avaient pas d’autres objectifs.
En phase avec ses trusts, le gouvernement américain défendait une ligne qu’il appelait « engagement », par laquelle il affirmait, avec toute l’hypocrisie dont sont capables les dirigeants impérialistes, faire du commerce le cheval de Troie capable de transformer la Chine, selon Clinton, en « une puissance responsable qui grandisse non seulement économiquement mais aussi en maturité politique jusqu’au point où les droits de l’homme seront respectés ». Ce qui leur importait, c’était surtout les droits de l’homme riche, de l’homme capitaliste et qui plus est américain.
Tiananmen, mais les affaires continuent
Pendant 30 ans, jusqu’au début des années 2010, rien, pas même le massacre de Tiananmen ne perturba cette convergence d’intérêts entre la bourgeoisie américaine et la bourgeoisie chinoise renaissante. Durant toutes ces années, la dictature qu’était le régime chinois ne les gênait pas.
En 1989, les manifestations d’étudiants et de travailleurs déferlèrent sur la Chine. Ils contestaient, outre l’absence de libertés politiques, l’inflation et la corruption du régime devenues endémiques depuis la réintroduction du marché. Pendant des semaines, ils manifestèrent toujours plus nombreux jusqu’à ce que, le 4 juin, le régime se décide à les écraser sous les chenilles de ses chars place Tiananmen. Pendant les mois qui suivirent, les arrestations et les exécutions se comptèrent par milliers dans tout le pays.
Après l’écrasement de Tiananmen, le président George Bush annonça qu’il suspendait toutes les ventes et les exportations d’armes vers la Chine ainsi que les échanges entre dirigeants militaires américains et chinois. Toutefois, ces mesures ne durèrent pas longtemps. George Bush écrivit même à Deng Xiaoping pour s’excuser de ces mesures qu’il avait dû prendre pour la forme. Et Henry Kissinger, l’inspirateur de la politique étrangère américaine depuis les années 1970, publiait dans le Washington Post du 1er août 1989 un article dont le titre « La caricature de Deng Xiaoping en tyran n’est pas juste » est tout un programme. Il écrivait : « Aucun gouvernement au monde n’aurait toléré de voir la principale place de la capitale occupée pendant huit semaines par des dizaines de milliers de manifestants… la répression était inévitable. » En réalité, le patronat américain qui investissait sur le marché chinois et qui en importait de plus en plus de marchandises en les revendant avec de bonnes marges, faisait tout pour que rien ne change…
Comme le formula cyniquement un ministre de la Défense chinois trente ans plus tard : « Grâce aux mesures prises à l’époque […] la Chine a joui de stabilité et de développement ». La répression de Tiananmen ne suspendit le cours de la première phase des réformes économiques que le temps d’étouffer complètement la contestation. La classe ouvrière avait été muselée, l’État chinois pensait avoir la voie libre pour l’attaquer frontalement.
L’État chinois contre la classe ouvrière…
L’offensive contre la classe ouvrière reprit avec la seconde phase des réformes économiques, lancée par Deng Xiaoping lui-même en 1992. Elle se traduisit d’abord par une privatisation de larges secteurs de l’économie. L’État prétendait, « conserver les gros poissons en laissant filer les petits », c’est-à-dire ne vendre que les petites entreprises. En fait, la plupart y passèrent. En 2001, 86 % des entreprises d’État avaient été restructurées et 70 % d’entre elles avaient été partiellement ou entièrement privatisées. Ce processus s’est accompagné du licenciement de 30 à 40 millions de travailleurs. En six ans, entre 1996 et 2001, l’emploi dans l’industrie manufacturière fut réduit de 40 %.
En s’attaquant aux emplois dans les entreprises d’État, le régime s’attaquait au statut d’une partie de la classe ouvrière, le « bol de riz en fer », synonyme de l’emploi à vie, d’un salaire garanti et à peu près égal entre ouvriers, d’une prise en charge des soins médicaux, de logements petits et spartiates mais pas chers, de la scolarisation, du droit à une retraite. Cette classe ouvrière des entreprises d’État, la moins mal lotie, qui n’avait aucun droit à l’expression libre ou à l’organisation syndicale ou politique en dehors des organisations du parti, fut massivement mise au chômage, libérée pour se faire embaucher dans des conditions bien pires dans les nouvelles entreprises privées.
Malgré la démoralisation des travailleurs après la défaite et la répression de 1989, il y eut des réactions, des dizaines de milliers de grèves, de manifestations, de pétitions, d’occupations d’usine et de destructions de bâtiments publics, de séquestration voire de lynchage de cadres. Il n’était pas rare que les travailleurs protestent au nom des intérêts politiques de leur classe, en affirmant que les ouvriers étaient les maîtres du pays, contre la nouvelle bourgeoisie, pour le socialisme et contre le capitalisme. Cependant, cette colère n’explosa qu’en ordre dispersé.
Les privatisations assurèrent l’ascension rapide des directeurs d’entreprises d’État, des dirigeants des gouvernements locaux, devenus à l’occasion propriétaires ou directeurs généraux d’entreprises privées. Un rapport révélait en 2002 que, dans 95 % des cas, les membres des anciennes directions étaient devenus les principaux investisseurs ou les nouveaux dirigeants des entreprises privatisées. Les dirigeants chinois tentaient ainsi de se donner une base sociale plus large. Mais ceux qui réussirent, qui devinrent immensément riches, étaient les plus intimement liés à l’appareil d’État. L’ascension de Desmond Shum et de sa compagne Whitney Duan, qui furent un temps parmi les plus riches Chinois, est typique. La famille de Desmond Shum est une de celles de ces capitalistes dits patriotes qui se sont expatriées à Hong Kong et qui revinrent faire des affaires au pays. Son père se fit l’intermédiaire de Tyson foods pour vendre en Chine les abats de poulet dont l’entreprise américaine ne savait que faire. Whitney Duan, employée de l’armée, récupéra pour son compte l’importation de matériel informatique pour l’armée lors de la privatisation des années 1990. Mais le couple n’atteignit des sommets que grâce à ses relations avec la femme du Premier ministre des années 2000, Wen Jiabao. Par son entremise, Shum et Duan obtinrent des marchés profitables, dont la construction d’un aéroport, des affaires sur lesquelles Tante Zhang, la femme de Wen Jiabao, touchait 20 % ou 30 %.
La caste dirigeante qui accapare le pouvoir économique et politique de l’État central et des provinces est constituée en Chine de 5 000 familles environ. Un journaliste a calculé que cette caste a accumulé en 30 ans 2 000 milliards de dollars. Parmi ces familles, celles des princes rouges, les descendants de révolutionnaires de 1949, représenteraient la moitié des milliardaires de Chine. L’homme le plus riche de Chine a longtemps été Wang Jianlin. C’est un ancien soldat de l’Armée populaire de libération, transféré sur le tard dans l’administration immobilière et qui a inventé avec Bo Xilai, le concurrent en 2012 de Xi Jinping pour le pouvoir, la corruption immobilière à grande échelle. Il a prospéré grâce aux investissements des hauts dirigeants, tels Xi Jinping, Hu Jintao et Wen Jiabao. Il aurait possédé jusqu’à 35 milliards de dollars. Hu Jintao, l’ancien secrétaire général du PCC qui, en octobre dernier, a été sorti par la sécurité en direct à la télévision du congrès du PCC, n’aurait possédé que quelques dizaines de millions d’euros. La famille de Bo Xilai aurait quant à elle transféré à l’étranger au fil des ans 6 milliards de dollars avant d’être violemment mise à l’écart.
Le pillage de ce que l’État avait mis des décennies à accumuler est à la base de l’émergence d’une grande bourgeoisie, composée aujourd’hui de quelques centaines de milliardaires en dollars, de plusieurs millions de millionnaires, et de plusieurs dizaines de millions de plus petits bourgeois, un vrai marché pour les entreprises chinoises et occidentales.
Celles-ci peuvent aussi exploiter les millions de travailleurs ruraux, de migrants de l’intérieur, qui ont quitté les campagnes à la recherche d’un salaire meilleur. Car si les réformes économiques ont enrichi une mince couche de paysans au début des années 1980, les conditions de vie à la campagne se sont dégradées très vite. L’ouverture au marché mondial, les importations de céréales firent baisser les prix des produits agricoles. De plus en plus de paysans ne pouvaient plus vivre de leur travail. Ils furent poussés vers les zones économiques spéciales à la recherche d’un emploi, souvent un petit boulot, dans les zones industrielles. De quelques millions dans les années 1970, ces mingong, ces travailleurs migrants de l’intérieur, étaient 150 millions en 2000, près de 300 millions en 2019, sur les chantiers, dans les usines « collectives » ou privées, dans les entreprises à capitaux étrangers ou mixtes, en étant concentrés par milliers, voire dizaines de milliers, dans des usines prisons, ou domestiques. C’est cette force de travail que l’État chinois a offerte à la bourgeoisie chinoise et occidentale.
Dans les usines du textile et de l’électronique chinoises, c’était souvent le travail six ou sept jours sur sept, 10 ou 12 heures par jour, dans des conditions terribles, avec des cadences infernales et pour des salaires misérables. Une migrante raconte que dans une imprimerie de Shenzhen, la commune en face de Hong-Kong où fut implantée une des premières ZES, il fallait travailler dans la chaleur et les vapeurs de produits chimiques, qu’au bout de quelques mois le cycle menstruel des femmes devenait irrégulier et qu’au bout de quelques années, elles ne parvenaient plus à contrôler leurs mouvements. Dans les fabriques de chaussures, à force de coller les semelles, les ouvrières perdaient définitivement toute sensation au bout des doigts et beaucoup se sont retrouvées partiellement ou entièrement paralysées. On trouve de nombreux témoignages de ce genre. Dans ces bagnes-usines, on mourrait aussi bien souvent d’accidents et les suicides étaient nombreux. En 2010, Foxconn a même fait la une de la presse pour ses filets anti-suicides. Les profits en Chine se font comme partout, avec le sang et la sueur de millions de travailleurs. Tout cela allait encore s’accélérer dans les années 2000.
L’atelier du monde impérialiste
Les autorités chinoises ont fêté leur entrée dans l’Organisation mondiale du commerce, l’OMC, en décembre 2001, avec autant de faste et d’orgueil que l’obtention par Pékin des Jeux Olympiques de 2008. La Chine était reconnue comme une puissance à part entière ! Mais pour y parvenir, elles ont d’abord dû subir un véritable chantage américain. L’ancien directeur de l’OMC, Pascal Lamy, qui a participé aux négociations avec la Chine, affirmait en 2021 : « La Chine a payé cher son accession à l’OMC, et bien plus que d’autres pays de sa catégorie à l’époque. » Réduction des tarifs douaniers de moitié en moyenne, ouverture des marchés des services et du secteur bancaire au capital étranger, ouverture du marché agricole introduisant la concurrence des céréaliers européens et américains… Les États-Unis faisaient rentrer la Chine dans leur monde, à leurs conditions.
Le pouvoir chinois n’avait de toute façon pas le choix. Les États-Unis avaient décidé non seulement de sous-traiter tout ce qu’ils pouvaient dans des pays à bas-salaires, mais aussi d’ouvrir leur propre marché à des produits fabriqués à des coûts de plus en plus bas, ce qui permettait y compris de comprimer les salaires des travailleurs américains en leur vendant des produits peu chers. Et les États-Unis pouvaient toujours changer de fournisseurs si les conditions qu’ils cherchaient n’étaient plus réunies. Ils pouvaient mettre en concurrence la Chine avec le Vietnam, l’Inde, l’Indonésie, ou le Mexique. Ils pouvaient fermer tout ou partie de leur marché à la Chine. Celle-ci à l’inverse ne pouvait pas se passer du marché américain. Elle s’intégrait dans l’économie mondiale comme sous-traitante de l’industrie occidentale, en vendant sa main-d’œuvre bon marché.
L’entrée dans l’OMC accéléra l’arrivée des capitaux étrangers. Les délocalisations concernaient à l’origine les secteurs du jouet, des vêtements, de l’assemblage des appareils de télévision. Elles furent étendues ensuite à des secteurs technologiques de plus en plus compétitifs, tel le matériel informatique, l’électronique. Dès 2010, la Chine était devenue le deuxième plus grand pays manufacturier du monde, devançant le Japon et derrière les États-Unis. Mais si cette évolution, les transferts de technologie, les progrès techniques et scientifiques chinois ont permis à nombre d’entreprises chinoises de commencer à concurrencer les entreprises étrangères, celles-ci y ont amassé des fortunes. En 2010, sur un baladeur Apple vendu 329 $ aux États-Unis et importés des usines chinoises, seuls 4 $ restaient en Chine. La plus-value produite par les ouvriers chinois était accaparée par les actionnaires occidentaux.
Un engagement sous pression
Parallèlement à son engagement économique, l’impérialisme a toujours maintenu sur la Chine une certaine pression militaire. Les États-Unis n’ont jamais abandonné Taïwan comme tête de pont dans la région. Le premier communiqué commun sino-américain signé à Shanghai en février 1972 reconnaissait qu’il n’y avait qu’une seule Chine mais sans trancher si cette Chine devait être dirigée de Taipei, la capitale de Taïwan, ou de Pékin. Ils maintinrent leur ambassade à Taipei jusqu’en 1979. Alors que le gouvernement américain officialisait ses liens diplomatiques avec Pékin, le Congrès votait le Taïwan Relations Act, par lequel les États-Unis s’autorisaient à vendre des armes à Taipei et à la soutenir militairement. Bref, la grande amitié entre la Chine et les États-Unis n’était pas fusionnelle, les États-Unis n’hésitaient pas à le rappeler.
Du côté des dirigeants chinois, les contradictions s’accumulaient. L’ouverture leur était des plus profitable, mais la Chine allait-elle se laisser dissoudre par le flot de dollars ? La Chine allait-elle de nouveau sombrer sous la pression impérialiste, comme à la fin du 19e siècle et au début du 20e ?
Jusque dans les années 1970, le parti centralisait tous les pouvoirs et dominait dans les entreprises. Au début des années 1980, le pouvoir relâcha les liens des entreprises avec le PCC, et plus généralement il relâcha les liens entre l’État central et les provinces, entre les gouvernements locaux et les collectivités, opérant un mouvement général de décentralisation de l’économie. Les provinces obtinrent l’autonomie financière. Les bureaucrates locaux pouvaient gérer leur budget en vendant à des promoteurs l’usage des terres des paysans. C’était à eux de faire en sorte que la colère soulevée par les opérations immobilières et la spéculation ne fassent pas trop de vagues.
Dans les entreprises, les directeurs devinrent responsables de leur conduite. Les entreprises étrangères devaient trouver les oreilles des fonctionnaires locaux pour faire leurs affaires. La corruption se développa à tous les étages. Après l’écrasement de Tiananmen, le PCC reçut la mission de constituer au sein des entreprises publiques « un noyau politique » afin de participer aux décisions importantes et d’empêcher « toute nouvelle perturbation politique ». La révolte de Tiananmen et les luttes ouvrières des années 1990 leur avaient montré que l’introduction du capitalisme accroissait les tensions dans la société. Mais la chute du mur de Berlin puis celle de l’URSS en 1991, interprétées par les officiels chinois comme le fruit de la faiblesse du PCUS face aux tendances centrifuges alimentées par les vents libéraux, leur montraient aussi que la décomposition et l’éclatement pouvaient aller vite. L’appartenance au PCC, qui compte des dizaines de millions d’adhérents, près de cent millions aujourd’hui, est essentielle pour ceux qui veulent faire carrière. Elle fournit aussi aux sommets dirigeants des leviers d’action directs et rapides dans toute la société chinoise, en doublant l’appareil d’État à de multiples niveaux, y compris dans la répression.
L’État chinois cherche à garder la main
Bien que l’État chinois ait promis à l’OMC d’aller encore plus loin dans l’ouverture de la Chine aux capitalistes étrangers, il chercha à garder la main sur un certain nombre de secteurs clé, l’énergie, l’Internet, l’aéronautique, le spatial et les télécommunications, la banque. Ainsi les joint-ventures n’étaient possibles que dans un nombre de secteurs : l’automobile, le commerce, la pharmacie, la restauration, l’agroalimentaire. L’État cherchait en même temps à faire émerger des entreprises capables de concurrencer les entreprises occidentales. Les pays impérialistes parlent pour cela de souveraineté. Les dirigeants chinois ne firent pas moins. En 2013, 57 entreprises chinoises étaient dans le classement Fortune des 500 plus grandes entreprises au monde. Presque toutes appartenaient à l’État. Très profitables, elles ont des quasi-monopoles dans le pétrole, le gaz, le nucléaire, l’électricité, les transports, les télécommunications, l’informatique et les services financiers.
De nombreuses autres entreprises sont soit sous le contrôle direct de l’État, soit sous le contrôle des différents échelons de collectivités publiques, des provinces, des districts, des municipalités. Et même quand elles sont privées, elles ont souvent des liens étroits avec l’appareil d’État, au travers de leurs dirigeants, de leurs actionnaires. Toutes ces entreprises bénéficient de nombreuses subventions indirectes : des terrains quasi gratuits, des taux d’intérêt très avantageux, une fiscalité bienveillante, des infrastructures à leurs mesures. Bref, bien plus que la « main invisible » du marché, c’est la « main bien visible » de l’État qui a permis l’essor économique des années 2000.
La crise économique mondiale de 2008 accentua l’intervention de l’État. La récession qui gagna alors la planète provoqua une baisse mondiale de la consommation de biens manufacturés, la base sur laquelle le capitalisme chinois prospérait depuis une dizaine d’années. Pour contrer les effets de la crise, le régime décida dès 2008 de plans de relance économique comparables à ceux des États-Unis. Le régime dépensa des milliers de milliards de dollars pour construire des lignes de chemins de fer, des aéroports, des zones industrielles, mais aussi des théâtres et des musées… La construction d’infrastructures et l’immobilier devinrent les nouveaux eldorados de la spéculation. Le Financial Times estimait en 2015 que la moitié des investissements, soit 6 800 milliards de dollars, ont été des dépenses inutiles. Inutiles peut-être mais ces milliers de milliards furent une bouée de sauvetage pour la bourgeoisie chinoise, ainsi que pour toute une partie de la bourgeoisie occidentale qui se précipita en Chine pour tenter de capter une partie de la manne. L’un dans l’autre, c’est la dette de l’État qui s’envola.
Ainsi, de cette période de développement capitaliste de la Chine, émergea une classe ouvrière, jeune, combative, forte de centaines de millions de membres, surexploitée aussi, dont le travail enrichit non seulement la bourgeoisie occidentale mais aussi une petite bourgeoisie et une bourgeoisie chinoise en pleine renaissance. Cette résurgence se fit sous la protection de l’État chinois qui, fort de son histoire, sut ne pas sombrer, mais même continuer à se développer et à assurer à cette nouvelle bourgeoisie sa part de profits. Sur le terrain économique, les entreprises occidentales étaient de plus en plus concurrencées, le marché chinois moins favorable, moins accessible, ce qui fit dire à Pascal Lamy : « La trajectoire de convergence avec le capitalisme de marché a été inversée. Si Pékin décide d’avoir 30 % de son économie nationalisée, c’est son choix, mais il faut qu’elle comprenne que c’est difficile de se battre avec les entreprises subventionnées. »
Loin de se dissoudre, l’État chinois se renforçait. Il allait de nouveau se heurter aux limites tolérées par l’impérialisme.
2011 à nos jours, le retour de la canonnière
Le pivot impérialiste vers l’Asie
Ce n’est pas Trump qui a changé la politique des États-Unis envers la Chine. Le tournant était en réflexion sous George Bush dès 2007. Et c’est la secrétaire d’État de Barack Obama, Hillary Clinton, qui en novembre 2011 annonça cette inflexion de la politique internationale des États-Unis baptisée « pivot stratégique » vers l’Asie du Sud-Est. L’objectif de cette politique était de placer l’impérialisme américain au cœur de la région devenue la plus dynamique de la planète pour qu’il y défende ses intérêts.
Jusqu’à la fin des années 2000, la priorité stratégique de l’impérialisme américain avait été l’Europe et le Moyen-Orient. En deux guerres, l’impérialisme américain avait réduit à un champ de ruines la puissance régionale qu’avait été l’Irak dans les années 1980. Cela lui avait coûté plusieurs milliers d’hommes et plusieurs milliers de milliards de dollars. En 2011, l’impérialisme pouvait se désengager du Moyen-Orient et basculer ses forces en Asie où il fallait canaliser, endiguer la Chine qui commençait à y prendre de la place.
Mike Pence, le vice-président de Trump, exprimait le 4 octobre 2018 dans un discours devant un parterre soigneusement sélectionné ce que pense une partie de la bourgeoisie américaine de la Chine. Après avoir fait le bilan de son développement, pour lequel il affirme que « Les investissements américains ont joué un rôle moteur », Mike Pence dénonce longuement l’État chinois, les protections et les subventions qu’il accorde aux entreprises chinoises, pour conclure : « Nous ne voulons pas que les marchés chinois souffrent. En fait, nous voulons qu’ils prospèrent. Mais les États-Unis veulent que Pékin adopte des politiques commerciales fondées sur la liberté, l’équité et la réciprocité. Et nous continuerons de tenir bon et de leur demander d’agir de la sorte. » Voilà réaffirmée une partie des objectifs des États-Unis. En accusant l’État chinois de protectionnisme, les États-Unis cherchent à faire pression contre les chasses gardées du marché chinois ou à défaut, à ne pas se faire grignoter leur propre marché, justifiant leur propre protectionnisme.
Sous la présidence d’Obama, les États-Unis proposèrent à certains pays de la région et de la côte Pacifique d’Amérique un nouvel accord de libre-échange tarifaire, le Trans-Pacific Partnership, le TPP, un accord qui excluait la Chine. Cette politique du TPP fut dénoncée par Trump, le successeur d’Obama, comme inefficace et insuffisante. Trump engagea les États-Unis sur une autre voie, celle de la guerre commerciale, en taxant un certain nombre de marchandises exportées vers les États-Unis mais aussi en interdisant à un certain nombre d’entreprises, comme ZTE et Huawei, de vendre leurs marchandises chez eux et chez leurs alliés.
La concurrence économique entre les États-Unis et la Chine dans certains secteurs s’intègre en réalité dans la lutte pour l’hégémonie mondiale. Et les États-Unis défendent leur position. Selon les mots de Mike Pence, « Pékin a pour priorité de développer les moyens de réduire les avantages militaires des États-Unis sur terre et sur mer, dans les airs et dans l’espace. La Chine cherche tout simplement à expulser les États-Unis d’Amérique hors du Pacifique ouest et tente de nous empêcher de venir en aide à nos alliés. » Mike Pence, qui s’inquiète par ailleurs de l’aide de la Chine « au régime corrompu et incompétent de Maduro […] dans notre propre hémisphère[3] », c’est-à-dire sous leur nez, dans leur pré-carré immédiat, exprime ici la réaction d’un parrain de la pègre dont le territoire commence à être contesté par un petit nouveau.
Les États-Unis complétèrent leur guerre commerciale par un accroissement de la pression militaire et diplomatique. Les redéploiements militaires commencés sous Obama ont amené la marine et l’aviation à basculer 60 % de leurs forces en Asie du Sud-Est. Les Américains ont entrepris de construire de nouvelles bases, de renforcer la coopération militaire avec le Japon, les Philippines, le Vietnam, la Malaisie. Avec le Japon, l’Inde et l’Australie, ils forment désormais une alliance, le Quad, pour Dialogue de sécurité quadrilatéral… Trump accéléra ce mouvement. Cela se lit dans les dépenses militaires des États-Unis. Si le retrait d’Irak puis celui d’Afghanistan avaient fait quelque peu régresser les dépenses militaires à 800 milliards de dollars en 2014, budgets annexes compris, elles sont depuis 2015 reparties en hausse vertigineuse. Elles étaient déjà de plus de 1000 milliards en 2020, spécialement orientées vers l’Asie et elles ont encore bien augmenté avec la guerre en Ukraine.
Tous ces efforts, tout ce déploiement militaire visent à faire pression sur la Chine pour qu’elle reste dans le cadre défini et toléré par l’impérialisme américain, compatible avec ses intérêts. Une version moderne de la politique de la canonnière.
Les points de friction régionaux
C’est un fait que la Chine ne fait plus profil bas sur la scène internationale, comme le disait Deng Xiaoping en son temps. Pour son développement, pour son existence même, elle n’a pas d’autre choix que de sortir de ses frontières et de se heurter aux limites que lui a imposées l’impérialisme dans les années 1950.
L’un des points de friction entre la Chine et les États-Unis et leurs alliés concerne la maîtrise des routes maritimes, non pas à l’autre bout de la planète mais à proximité des côtes chinoises. Si la Chine possède 18 000 km de façade maritime, celle-ci débouche partout sur des mers semi-fermées par ses voisins et rivaux : le Vietnam, la Malaisie, les Philippines au sud ; plus au nord, Taïwan ; encore plus au nord, le Japon et les îles Senkaku, que la Chine revendique, et la Corée du Sud. La plupart de ces États sont des alliés de longue date des États-Unis. Même le Vietnam s’en est rapproché, accueillant récemment un de ses porte-avions et recevant en don plusieurs patrouilleurs. Et si les Philippines ont cherché un temps à se rapprocher de la Chine, elles ont toujours tenu à leur alliance avec les États-Unis et le Japon. À l’extrémité occidentale de cette région, le détroit de Malacca est stratégique. Il voit passer un tiers du commerce mondial en valeur, la moitié du tonnage maritime mondial, cinq fois plus que le canal de Suez. C’est la route la plus courte entre l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie de l’Est, où passent les deux tiers du pétrole consommé dans cette région et 90 % du commerce extérieur chinois. Avec la marine qu’il a déployée dans la région, l’État américain a la capacité d’interrompre à tout moment le trafic commercial chinois. En contrôlant toutes les issues maritimes, il a les moyens d’empêcher la marine militaire chinoise d’accéder aux océans Pacifique et Indien.
Dans cet ensemble, la mer de Chine méridionale, entre le détroit de Malacca et les grands ports chinois, joue un rôle particulier. Elle est bordée par huit pays qui ont tous des revendications sur les îles et la multitude de simples récifs, d’écueils, voire de bancs de sable partiellement émergés qui la parsèment. La Chine ne se conduit pas autrement, elle les a intégrés, comme Taïwan et le Tibet, dans le périmètre de son « intérêt national ». Quand en 2009, le Vietnam et les Philippines voulurent étendre leurs zones économiques dans des zones maritimes occupées par la Chine, la Chine commença à poldériser et à militariser les îlots qu’elle contrôlait, construisant sur plusieurs d’entre eux des bases aériennes et des bases navales en gagnant sur la mer, multipliant ainsi les points d’accrochage avec ses voisins et la marine américaine.
Avec le développement économique qui est le sien, en État bourgeois responsable des intérêts de sa classe dominante, la Chine ne peut pas tolérer un statu quo qui mette ses routes commerciales, et donc son économie, sous la pression d’autres pays. La crise de 2008 la poussa plus loin encore. Les centaines de milliards déversés dans l’économie pour sauver la bourgeoisie chinoise et internationale de la banqueroute ont favorisé le développement des capacités de production à un point tel qu’il était évident, dès 2013, que ces capacités dépassaient, et de très loin, les besoins. L’économie ne tient que par la spéculation immobilière et parce que l’État soutient à bout de bras nombre d’entreprises. Et la classe ouvrière chinoise se bat, notamment pour les salaires. En 2010, des conflits spectaculaires ont éclaté dans le Guangdong, vers Hong-Kong, marquées par des grèves massives dans les usines Honda et des manifestations dans le monde paysan. Cent quatre-vingt mille « incidents de masse », grèves, manifestations, furent officiellement recensés en 2011, soit 2,5 fois plus qu’en 2008… La peur des réactions de la classe ouvrière, la nécessité de trouver des marchés pour une industrie sous-occupée poussa l’État chinois sur ce qu’il a appelé, en jouant sur la corde de la grandeur chinoise passée, les Nouvelles routes de la soie. Inaugurées en 2013 par Xi Jinping, tout juste nommé à la tête de l’État, elles consistent pour une bonne part à prêter à des États comme le Pakistan, le Sri Lanka, la Malaisie, le Venezuela, le Kenya… de quoi financer des travaux pour des infrastructures dont l’utilité n’est pas toujours évidente. En retour, ces États en confient la réalisation à des entreprises chinoises, charge à eux de faire payer leurs populations. Les nouvelles routes de la soie ne se réduisent pas à de simples considérations économiques. Alors que les États-Unis tentent d’enrôler certains de ces pays dans leur politique d’endiguement, la Chine utilise les milliards des routes de la soie pour faire contrepoids et en rapprocher politiquement d’elle un certain nombre en Asie et en Afrique.
Une pression américaine de plus en plus forte
Face au développement de la Chine, les États-Unis ont accru leur pression à ses frontières, une pression qui se matérialise depuis 2015 par des patrouilles maritimes en mer de Chine, prétendant vérifier, au nom du respect du droit international, qu’elle est libre et ouverte à tous. Mais c’est bien à chaque fois une démonstration de force de l’impérialisme. Les Chinois répliquent à ces provocations en envoyant à leur tour des avions et des bâtiments de guerre sur zone, ou en tirant des missiles surnommés tueurs de porte-avions. Jusqu’ici, les manœuvres ont été de part et d’autre minutieusement calibrées pour éviter tout dérapage. Mais en 2018, un destroyer chinois s’est rapproché à moins de 40 m d’un destroyer américain au cours d’une de ces opérations.
La Chine est ceinturée par les États-Unis : bases en Thaïlande, à Singapour, aux Philippines, en Corée du Sud, au Japon, en Australie, sur l’île de Guam. La flotte américaine est en permanence sur zone, à l’est de Taïwan, dans l’Océan Indien, en mer de Chine méridionale. Et l’armée américaine a décidé d’éparpiller ses bases et ses troupes afin, dit-elle, d’éviter de tout perdre dans un nouveau Pearl Harbor. Lloyd Austin, secrétaire d’État américain à la défense, annonçait il y a quelques jours le déploiement d’une force de réaction rapide des marines sur leur base d’Okinawa, une force qu’il a qualifiée de « plus létale et plus mobile » que le régiment d’artillerie actuellement installé. S’ils ne font pas la guerre, ils s’y préparent.
La stratégie dite indopacifique des États-Unis, telle qu’elle se nomme depuis Trump, consiste aussi à associer leurs alliés traditionnels à des exercices militaires conjoints toujours plus nombreux et à leur demande d’augmenter leurs budgets militaires. Ils ont entraîné avec eux l’Australie dans l’alliance AUKUS avec le Royaume-Uni dont le renouvellement en 2021 s’est traduit par la vente à la marine australienne de 8 sous-marins nucléaires d’attaque fabriqués aux États-Unis, au grand dam du Français Naval Group. Ils entraînent avec eux l’Inde dans des manœuvres navales chaque année. Quant au Japon, bien intégré au dispositif américain, le gouvernement vient d’annoncer qu’il allait doubler ses dépenses militaires.
Dernier épisode : un accord conclu début février avec l’État philippin pour l’établissement de quatre nouvelles bases militaires américaines aux Philippines, des bases qui compléteront l’encerclement des côtes chinoises. C’est une politique systématique, qui ne néglige rien. Les États-Unis ont annoncé qu’ils allaient ouvrir des ambassades aux Tonga et à Kiribati, 100 000 habitants chacun, et des accords militaires ont été signés avec les îles Marshall et Palaos, 70 000 et 20 000 habitants. La Chine a progressé dans les îles Salomon, mais en Micronésie ce sont les États-Unis qui ont signé un accord militaire en 2021.
Dans cette partie de jeu de go où se joue la vie des peuples, la place des impérialismes de second ordre, comme la France ou le Royaume-Uni semble dérisoire. Pourtant l’État français se targue d’être une puissance qui a des intérêts à défendre dans l’Indo-Pacifique parce qu’il dispose de territoires et de bases militaires dans le Pacifique et l’Océan Indien. Entre la Chine et les États-Unis, la France affirme même vouloir offrir une troisième voie, ce qui lui permet surtout de conserver de bonnes relations commerciales avec le plus de pays possible. Mais en pratique, le petit impérialisme français, comme l’impérialisme anglais, s’aligne derrière les États-Unis, en défendant le statu quo, c’est-à-dire le maintien en l’état des positions dominantes de l’impérialisme américain. Il participe ainsi en mer de Chine méridionale à des opérations de « liberté de navigation » et à des exercices militaires conjoints avec les États-Unis.
Au bilan, la présidence de Trump aura donc vu l’impérialisme américain pousser son offensive en règle contre la Chine, dans le ton comme dans les actes. Le Démocrate Joe Biden a poursuivi cette politique, sur le plan militaire, comme sur le plan commercial. Ainsi, à la veille du dernier congrès du PCC en octobre dernier, l’équipe de Biden affirmait que sa « priorité est de conserver son avantage compétitif sur la Chine » et que « La République populaire de Chine est le seul compétiteur qui a l’intention de reformater l’ordre international, et qui possède aussi, de plus en plus, le pouvoir économique, diplomatique, militaire et technologique pour parvenir à ses fins. » Les mesures américaines ne se firent pas attendre. L’État américain a décrété un quasi-embargo sur la fourniture à la Chine des semi-conducteurs les plus performants ainsi que des machines permettant de les fabriquer. La Chine vient bien de répliquer en annonçant un plan étatique de 143 milliards de dollars pour développer elle-même ces semi-conducteurs. Mais les entreprises, la néerlandaise ASML et les japonaises, Tokyo Electron et Nikon, qui ont un quasi-monopole sur les machines qui permettent de produire ces puces, ont obtempéré aux injonctions américaines, ce qui ne peut que compliquer les tentatives chinoises de rattrapage technologique. Biden exacerbe ainsi la guerre commerciale par la guerre des puces. Apple qui avait annoncé qu’il se fournirait en puces mémoire auprès du Chinois YMTC a renoncé après la mise à l’index de l’entreprise.
Quant à Taïwan, Joe Biden y a organisé en août la visite de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants ainsi que la visite de plusieurs secrétaires d’État. Lui qui s’est fait élire en promettant la paix, montre qu’il considère Taïwan comme un État indépendant, ce qui est une provocation de fait à l’égard de Pékin, qui affirme depuis 40 ans que la Chine ne tolérera pas une indépendance formelle de Taïwan. Depuis que Joe Biden a été élu, au moins neuf ventes d’armes à Taipei ont été approuvées par le gouvernement américain. Et régulièrement, des navires de guerre américains entrent dans le détroit de Taïwan au risque de provoquer un incident militaire.
La Chine, poussée par ses contradictions internes
Avec le ralentissement de l’économie mondiale, la bourgeoisie chinoise doit faire face au ralentissement de sa propre économie. Selon l’aveu de l’ex-Premier ministre Li Keqiang en 2020, 600 millions de Chinois doivent vivre avec moins de 150 euros par mois et restent dans la grande pauvreté. Si les provinces côtières se sont bel et bien développées autour des grandes métropoles comme Shanghai et Pékin, les campagnes restent en retard. Quant à l’avenir, il se dessine comme partout sur la planète capitaliste : sombre. Et c’est à la classe ouvrière que la bourgeoisie présentera la facture. Des capitalistes, y compris chinois, considèrent que les salaires chinois sont devenus trop élevés. Certains, notamment dans le textile depuis les années 2010, ont déjà choisi de délocaliser une partie de leur production en Inde ou au Vietnam. Le taux de chômage des jeunes, en particulier des jeunes diplômés, a d’ailleurs déjà tendance à s’élever. Les menaces de krach immobilier aggravent la situation. Cette semaine, on a appris que, pour équilibrer leurs budgets qui dépendent de la vente des terrains immobiliers, qui a chuté, des gouvernements locaux ont amputé les salaires de fonctionnaires et réduit le chauffage dans des villes du Nord. À Wuhan, des dizaines de milliers de retraités ont protesté contre la diminution drastique des remboursements de la sécurité sociale gérée par ces gouvernements locaux.
La guerre économique de Trump et de Biden ne peut qu’aggraver les choses. Ainsi, après les dernières sanctions américaines, Apple a annoncé qu’il ferait produire la moitié de ses Iphone en Inde d’ici 2027 alors que plus de 80 % viennent actuellement de Chine, produits notamment par ces ouvriers de Foxconn qui se sont révoltés en octobre dernier contre leur confinement au travail. D’autres grandes entreprises ont fait des annonces similaires, une orientation que certains appellent le découplage entre les économies occidentales et l’économie chinoise. L’avenir dira ce qu’il en est exactement, car en réalité, chaque capitaliste fait son calcul en fonction de ses profits, en prenant en compte non seulement les sanctions américaines, les salaires, les tarifs douaniers, mais aussi les avantages en infrastructure et en niveau d’éducation des travailleurs dont ils disposent dans tel ou tel pays. Globalement, si les importations de marchandises chinoises aux États-Unis restent élevées, elles tendent à progresser moins vite que celles de leurs concurrents en Europe ou au Vietnam. Il semble que les capitalistes américains diversifient effectivement leurs approvisionnements. Cependant, ce sont toujours des centaines de milliards qui chaque année s’en exportent aux États-Unis. La Chine reste encore largement dans sa fonction d’atelier du monde.
Dans les calculs des capitalistes occidentaux, pèsent le marché intérieur chinois et ses nouveaux bourgeois et petits-bourgeois. Certes, certains y renoncent, comme PSA face à la concurrence des constructeurs locaux. Mais pour d’autres comme Volkswagen, qui vend en Chine plus de 3 millions de véhicules, pour LVMH, Total, ainsi que pour des trusts américains comme GM ou Exxon, il est hors de question de partir. La bourgeoisie allemande n’a jamais autant investi là-bas.
Malgré tout, le ralentissement de l’économie mondiale depuis la crise de 2008 et les deux dernières années de pandémie ont aggravé les difficultés de l’économie chinoise. Les confinements à répétition, les usines à l’arrêt ou en service réduit, même lorsqu’elles étaient en « boucle fermée », les travailleurs enfermés 24 heures sur 24 dans les ateliers, ont réduit la production et les exportations. De nombreuses usines petites et moyennes, qui avaient fermé leurs portes, ne les ont pas encore rouvertes. De nombreux migrants sont repartis dans leur village d’origine ou sont devenus livreurs à domicile.
Avec ces difficultés qui s’accumulent, la lutte contre la corruption offre à la dictature chinoise une opportunité politique évidente. La corruption, qui choque la population, est aussi un risque politique pour le pouvoir, car les sommets ne peuvent pas en être exempts. Aussi quand Xi Jinping se lance dès son arrivée au pouvoir dans la lutte anti-corruption, il s’agit d’abord de s’assurer le contrôle sur les affaires qui pourraient sortir, mais aussi d’asseoir sa légitimité en répondant à des aspirations populaires, en en profitant au passage pour écarter ses concurrents politiques. Il assure ainsi une certaine cohésion de l’appareil d’État. Aucune voix dissonante dans les hautes sphères ne saurait être tolérée.
Il en va de même de la mise au pas d’un certain nombre de grands capitalistes, ce qui serait inenvisageable dans un pays occidental. Le dernier en date à avoir été appréhendé il y a quelques jours, c’est le milliardaire Bao Fan. Mais Jack Ma, le patron d’Alibaba, a semble t-il failli subir le même sort. Le pouvoir a bloqué l’introduction à la bourse de New-York de sa filiale Ant. Et il a disparu de la scène publique pendant plusieurs mois fin 2020. Pour les médias occidentaux, Jack Ma a eu le tort le critiquer le système financier chinois, pas assez libéral à son goût. En réalité, un certain nombre d’entreprises privées chinoises ont atteint une telle taille qu’elles pourraient s’émanciper du parti et de l’État. Ce n’est pas pour rien que Xi Jinping les a rappelées à l’ordre. Le contexte international, l’affrontement avec les États-Unis poussent au contrôle plus étroit des entreprises privées chinoises par l’État. La bourgeoisie chinoise est intimement liée à l’État, elle en sort, elle lui doit tout. Et l’État chinois sait, encore, le lui rappeler.
Enfin, comme tous les États coincés dans leurs frontières nationales où les difficultés s’accumulent, l’État chinois ne peut que tenter d’enrégimenter la population dans un nationalisme de plus en plus affirmé. Taïwan sert d’exutoire, tout comme le souvenir du siècle d’humiliation que le gouvernement chinois entretient dans sa propagande. Le nationalisme chinois, complété d’un racisme d’État envers tous ceux qui ne sont pas Han, comme les Ouighours et les Tibétains, est ainsi une tentative pour l’État chinois de maintenir la société sous sa coupe, malgré les difficultés croissantes.
Puissance militaire et impérialisme
Dans la montée des tensions, les États-Unis se justifient en mettant en avant la puissance militaire chinoise, ce qui permet à Xi Jinping de développer une propagande symétrique, justifiant auprès de la population les budgets militaires. Mais, même si l’armée chinoise progresse à grand pas, elle est loin de l’image que veut en donner la presse occidentale. Elle est certes nombreuse, deux millions d’hommes, contre 1,35 million d’hommes pour les États-Unis. Mais, alors que le budget chinois finance surtout des effectifs, le budget américain sert à acheter des armes de haute technologie auprès d’une industrie qui en a le quasi-monopole mondial. Le budget de la défense américain est au moins trois fois supérieur au budget militaire chinois. L’armée des États-Unis surclasse partout celle de la Chine, dans le nucléaire, dans les airs, en quantité et en avance technologique… Même sur les mers. La presse occidentale insiste sur le nombre de bâtiments chinois, 360, effectivement supérieur aux 297 bâtiments américains. Mais c’est sans compter les alliés des États-Unis, et c’est sans dire que la Chine fait flotter essentiellement des patrouilleurs, tandis que les États-Unis mettent en ligne onze porte-avions nucléaires capables d’embarquer des centaines d’aéronefs. Pékin ne possède que deux porte-avions de génération soviétique, dont l’autonomie et le rayon d’action sont bien moins importants.
L’armement ne fait pas tout. Ainsi l’impérialisme américain dispose de 800 bases opérationnelles à travers le monde, avec 200 000 hommes, tandis que la Chine n’en a qu’une en Afrique, à Djibouti, là où la France, un impérialisme de seconde zone, en dispose de 4 et déploie des troupes dans 5 autres pays. Dans la réalité, le détroit de Malacca, les mers de Chine sont sous contrôle américain. Ce n’est donc pas demain la veille que la Chine va occuper le Pacifique et naviguer sous les côtes de Californie. Contrairement aux États-Unis, qui eux, naviguent en ce moment sous les côtes chinoises.
La Chine est-elle un nouvel impérialisme ? Comme toutes les puissances capitalistes, la Chine cherche à exporter ses capitaux, à gagner des marchés, à assurer ses approvisionnements en matières premières, en séduisant ou en menaçant ses voisins. Il n’y a là rien de très original. Le Qatar qui s’est approprié le PSG est-il pour autant une puissance impérialiste ? L’impérialisme, c’est la mobilisation des forces armées pour défendre les intérêts économiques des grands groupes capitalistes nationaux qui exportent massivement leurs capitaux. La Chine est bien capable de prêter de l’argent à tel ou tel pays pour qu’il passe commande à des entreprises chinoises, mais c’est l’État qui le fait, pas des banques privées, et la Chine n’a encore jamais projeté de forces militaires à l’extérieur de ses frontières pour imposer le respect d’accords commerciaux ou le remboursement de prêts. Elle en est réduite à pratiquer le « soft power », c’est-à-dire à convaincre et à séduire, là où l’impérialisme lui laisse des espaces, comme en Afrique, quand il s’en détourne. Globalement, c’est la Chine qui reste une destination pour les capitaux des pays impérialistes, plutôt que l’inverse.
La dynamique à l’œuvre
Que ce soit au début du 20e siècle ou après la crise de 1929, les pays impérialistes qui ont dominé la planète n’ont jamais toléré qu’un concurrent vienne empiéter sur leurs zones d’influence et grignoter leurs parts de marché. Au niveau régional ou au niveau mondial, c’est à chaque fois la guerre qui a tranché la question de la puissance qui dominerait. Les États-Unis sont sortis de la Seconde Guerre mondiale comme l’impérialisme dominant tous les autres, sans partage. Cette guerre, ses massacres, ses destructions ont permis au capitalisme de rebondir pendant une vingtaine d’années, mais la crise de l’économie capitaliste ne cesse de s’approfondir depuis les années 1970. La lutte pour le contrôle des marchés et des sources d’approvisionnement en matières premières et en main-d’œuvre bon marché, ne peut en être que plus féroce. Si la Chine a pu offrir à l’impérialisme de nouvelles sources de profit, en mettant à sa disposition son prolétariat nombreux et éduqué, c’est au prix du développement d’un État en mesure de contester les intérêts de la bourgeoisie américaine ; un État qui regroupe 1 milliard et 400 millions de personnes sur un sixième du globe, ce qui lui donne une force et des moyens non négligeables ; un État qui s’est construit de façon indépendante de l’impérialisme et que l’impérialisme n’a pas réussi à soumettre. Comme la Russie et dans une moindre mesure l’Iran, l’impérialisme américain ne peut pas la laisser faire.
Les tensions entre les États-Unis et la Chine ne vont donc pas s’atténuer. Fondamentalement, elles sont le fruit du monde capitaliste, d’un monde divisé en États-nation et dominé par l’impérialisme. Elles sont la preuve que sur cette planète capitaliste, il n’y a pas de solution nationale. L’histoire de la Chine le démontre, tout développement national ne peut se faire qu’aux conditions de l’impérialisme, et dans les limites imposées par l’impérialisme.
Ces tensions déboucheront-elles sur la guerre ? En tout cas, les gouvernements occidentaux avant d’enrôler les hommes cherchent à enrôler les esprits. Les États-Unis cherchent à associer la Chine à Poutine et à la guerre en Ukraine, en l’accusant d’aider la Russie en sous-main. Alors que les écoutes de la NSA sont la règle, les gouvernements américains ou australiens font démonter les caméras de marque chinoise, interdisent la 5G chinoise et même TikTok, accusés de nous espionner. Tout est bon dans l’escalade. Le summum, ces dernières semaines, fut sans doute l’affaire du ballon-sonde chinois, accusé d’espionnage et abattu en direct à la télévision par les États-Unis, eux qui avec leurs satellites et leur contrôle sur Internet espionnent la planète 24 heures sur 24.
Malgré les tensions internationales et les pressions de l’impérialisme américain, l’interdépendance des économies américaines, européennes et japonaises avec l’économie chinoise reste forte. Mais une telle interdépendance n’a jamais empêché les guerres d’éclater. Si la situation dégénère, les entreprises s’adapteront, changeront de nationalité comme Ford en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, ou périront. Les États défendent les intérêts généraux de leur bourgeoisie, malgré ou par-dessus les intérêts particuliers quand il le faut.
Il est bien peu probable que la Chine attaque frontalement les États-Unis. Mais si ces derniers poussent Taïwan à se déclarer officiellement indépendante, si l’accumulation de bâtiments de guerre en mer de Chine mène à l’incident ou si les États-Unis se décident à y reprendre aux Chinois quelques îlots, jusqu’où ira l’escalade guerrière ? Jusqu’où iront les uns et les autres ? C’est bien difficile à dire. En tout cas, les travailleurs ne peuvent pas compter sur les mécanismes de l’économie capitaliste pour éviter la catastrophe.
Bien au contraire. Aujourd’hui, l’impérialisme américain manœuvre pour que la Chine reste à sa place et ouvre plus son économie. Il lui mène une guerre économique pour cela, et il fait donner, en appui, son armada. Mais les guerres économiques sont souvent le prélude des guerres tout court. Ce fut le cas après 1929, quand le protectionnisme gagna les pays industrialisés. « La guerre impérialiste est la continuation et l’exacerbation de la politique de pillage de la bourgeoisie », écrivait Trotsky en 1938 dans le Programme de transition. Seul le renversement de l’impérialisme peut réellement assurer la paix.
La force sociale capable d’une telle révolution existe. C’est la classe ouvrière internationale. Celle de Chine est devenue la plus nombreuse au monde, reliée par mille liens à la classe ouvrière européenne et américaine. Les milliers d’ouvriers chinois de Foxconn, qui se sont révoltés contre le confinement en novembre, sont sous-traitant de l’américain Apple et leur patron est taïwanais. Malgré la dictature policière, cette classe ouvrière chinoise se bat. Des militants ouvriers en Chine devraient donner à la lutte contre leur bourgeoisie un caractère internationaliste, tirant les leçons du passé, affirmant que, même à l’échelle d’un pays comme la Chine, il n’y a pas de perspectives à long terme sans renversement de l’impérialisme. Ils rejoindraient le combat des ouvriers conscients d’Europe et d’Amérique en lutte contre leur propre bourgeoisie, celle des pays impérialistes qui dominent le monde. Pour éviter la guerre, il n’y a pas d’autre voie que la révolution sociale, à l’échelle de la planète.
[1] La guerre des paysans en Chine et le prolétariat, Trotsky, septembre 1932
[2] Ibid
[3] Le Venezuela.